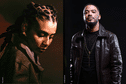C’est confirmé : il ne fait pas bon être jeune en Martinique en 2021. En Guadeloupe non plus d’ailleurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets. À ce propos, la crise multiple que nous vivons est similaire à celle de février-mars 2009, convenons-en. Aujourd’hui comme il y a 11 ans, la jeunesse était l’un des pôles du mouvement populaire de protestation.
Sauf qu’il existe une différence majeure, concernant les jeunes, entre ces deux crises. Elle tient aux délits qui leur sont imputés : pillages, incendies, racket et violences sexuelles sur les barrages. Ou encore l’interdiction pour les malades d’aller se soigner et les soignants d’aller travailler. Sans oublier les tentatives de meurtre sur des policiers et gendarmes.
Ces exactions seraient le fait des jeunes, mis globalement dans le même sac. Est-ce à dire que tous les jeunes sont des délinquants ? Et que tous les criminels sont des jeunes ? Bien évidemment, la réponse est négative. Mais la tentation de l’amalgame facile est là, empêchant de voir la grande diversité de cette couche sociale multiforme, la jeunesse, et d’entendre ses appels.
Une analyse proche de la réalité
En ce sens, l’approche fine réalisée par le sociologue martiniquais André Lucrèce est éloquente. Dans sa dernière tribune du 3 décembre il évoque les attentes exprimées par des jeunes rencontrés sur les barricades.
Il nous dit que ceux-ci expriment une forte demande d’apprentissage de normes sociales, de codes de comportement et de valeurs culturelles. Cette socialisation s’effectue au sein de la famille. Or, la place de la famille a considérablement diminué depuis une ou deux générations, nous dit André Lucrèce.
Pour lui, l’un des paradoxes de cette crise est qu’une fraction des jeunes attend que les adultes les guident dans le monde d’aujourd’hui. « C’est aussi cet appel qu’ils lancent sur les ronds-points. Ne décevons pas cette attente » conclut Lucrèce.
La société antillaise est bloquée
Un vrai défi, car notre société paraît bloquée. L’expression est du sociologue français Michel Crozier. Il expliquait la survenue de Mai-68 par le verrouillage de la France, dont les jeunes souffraient. La société des Antilles françaises n’est-elle pas bloquée elle aussi, en empêchant l’émergence de talents et d’idées neuves ?
Or, qu’apprenons-nous à nos enfants ? Quel modèle de société leur proposons-nous ? Quel idéal leur traçons-nous ? Quelles valeurs leur inculquons-nous ? Quels horizons leur montrons-nous ? S’ils se révoltent aujourd’hui, maladroitement parfois, mais légitimement toujours, n’en sommes-nous pas responsables ?
Que font les syndicats d’enseignants si prompts à défendre leurs acquis sociaux ? Les entendons-nous ou les voyons-nous remettre en cause les méthodes pédagogiques et les contenus enseignés afin de juguler l’échec scolaire ?
Qui est responsable de nos enfants ?
Que font les pouvoirs publics, hormis des dispositifs aussi complexes que généreux et néanmoins provisoires pour créer des emplois pérennes ? Que font nos chefs d’entreprise pour embaucher à leur juste valeur des jeunes dont beaucoup de diplômés, du CAP au doctorat, doivent se contenter de salaires ridiculement bas ?
Que font nos formations politiques pour encadrer et former ces jeunes désireux de se lancer dans l’action publique ou civique ? Et les syndicats, si prompts à établir des barricades sur les ronds-points pour gêner la population qu’ils prétendent représenter et défendre ?
N’aurions-nous que le brutalisme à proposer à nos enfants ? Le brutalisme est un concept élaboré par le politologue et historien camerounais Achille Mbembé. Il s’agit de l’émergence de la violence sociale dans le but de rechercher la puissance conférée par l’accumulation des biens matériels. Nous y sommes, apparemment.
Le dicton selon lequel nous avons les élus que nous méritons signifie que nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes pour n’avoir pas choisi une élite politique mieux inspirée que celle que nous avons mis en place. En paraphrasant ce dicton, nous pourrions commencer à nous avouer que nous avons les jeunes que nous méritons.