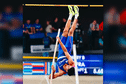Un siècle, deux décennies et deux ans. Cela donne 122 ans exactement que le droit de vote des femmes est devenue une revendication politique. Le 8 mars 1910, des militantes socialistes européennes réunies en congrès à Copenhague, au Danemark, décident de consacrer chaque année un moment « à la propagande en faveur du vote des femmes ». L’initiative de la journaliste progressiste allemande Clara Zetkin est validée.
Une décision en écho à l’instauration, un an auparavant, le 28 février 1909, d’une journée nationale de la femme aux États-Unis à la demande du Parti socialiste d'Amérique. Mais c’est après la Première Guerre mondiale que cette idée se généralise. Le mouvement communiste international s’empare d’une revendication subversive combattue par les conservateurs.
La détermination des féministes, notamment la révolutionnaire russe Rosa Luxembourg est telle que, progressivement, plusieurs dizaines de pays dans le monde légalisent ce nouveau droit ouvert à la moitié de la population. Les derniers à s’être conformés à cette obligation morale et politique, qui plus est ces deux dernières décennies seulement, sont les Etats du Golfe arabo-persique, dirigés par des monarchies rétrogrades, comme chacun sait.
Un droit acquis sur toute la planète
En France, en dépit de l’ancienneté de la revendication portée notamment par Olympe de Gouges dès la Révolution de 1789, c’est après la Seconde guerre mondiale que les femmes deviennent des citoyennes à part entière. Sous la pression insistante du Parti communiste, le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle ouvre les registres électoraux aux femmes en 1944. Elles exerceront ce droit lors des législatives et des municipales l’année suivante.
Dans les colonies, ce droit est appliqué en priorité là où il existe une forte revendication d’égalité des droits. Les femmes de Guadeloupe et de Martinique peuvent voter comme les autres femmes de France. Un droit ignoré dans les possessions d’Afrique, jusqu’à la loi-cadre portée par le ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre, en 1956.
Ceci étant, ce droit nouveau ne va pas de soi en raison du machisme omniprésent. Chez nous, l’Union des femmes de Martinique le réclamait depuis longtemps. Une revendication parmi d’autres. L’UFM exige l’abolition de nombreux interdits à caractère sexiste comme l’interdiction pour une femme de posséder un compte bancaire, l’autorisation préalable de son mari pour travailler, l’interdiction de la contraception et du divorce par consentement mutuel.
Une revendication en appelle l’autre
Et bien sûr, l’UFM mène un combat pour le libre-accès des femmes à l’engagement politique. Inimaginable aujourd’hui, même si certains freins psychologiques hérités du passé persistent. La moitié de nos élus locaux et parlementaires sont du genre féminin, c’est vrai, mais l’exercice des plus hautes responsabilités politiques leur échappe encore trop souvent.
Pour autant, nous savons bien que les révolutions triomphent avec le temps. La détermination et la justesse de l’analyse finissant par s’imposer. L’égalité entre femmes et hommes, sur tous les plans, est l’une de ces révolutions. Le combat n’est pas encore définitivement gagné, mais la lutte finit toujours par payer