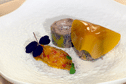« La seule discrimination dont puissent aujourd'hui se plaindre les citoyens français d'outre-mer est une discrimination positive massive ». Vous avez bien lu, et c'est écrit dans le "Dictionnaire historique et critique du racisme", paru chez PUF en mai 2013.
Sous la direction du philosophe et historien Pierre-André Taguieff, le "Dictionnaire historique et critique du racisme", a été publié en mai 2013 aux Presses universitaires de France (PUF). Gros pavé de 2016 pages, ce livre se présente également comme "un dictionnaire de l'antiracisme". Sa fiche de présentation, sur le site des éditions des PUF, précise qu'il comporte 540 articles rédigés par 250 spécialistes « pour lutter contre les racismes en connaissance de cause et avec la lucidité requise ». Voire.
Sous l'article consacré, dans cet ouvrage, à l'Affirmative action (expression américaine mal traduite en France par « discrimination positive »), le texte évoque une « discrimination positive massive » en faveur des Ultramarins : « La seule discrimination dont puissent aujourd'hui se plaindre les citoyens français d'outre-mer est une discrimination positive massive : majoration de salaires et de retraites, exonérations sociales et fiscales, subventions à perte de vue, primes de toutes sortes, y compris les voyages gratuits ou à prix réduit vers la métropole au nom de la "continuité territoriale" ». « L'accès à l'université des "domiens" ne pose plus aucun problème », poursuit également l’auteur de l’article, Anne-Marie Le Pourhiet, professeur agrégé de droit public à l'université de Rennes 1, qui reprend à son compte les clichés habituels.
Elle continue : « alors que la situation n'a rien à voir avec les Etats-Unis ou l'Afrique du Sud, il a fallu fabriquer de toutes pièces un prétexte selon lequel les populations "issues de l'immigration" seraient "au quotidien" victimes de discriminations ». Et pourquoi ne pas dire carrément que les discriminations n’existent pas ?
Mais ce n’est pas fini. « Il n’en demeure pas moins que puisqu’il faut se dire victime de l’autre pour pouvoir justifier qu’on lui passe devant, le militantisme féministe a aussi forgé son passé discriminatoire », dit-elle. Inventé peut-être ? Anne-Marie Le Pourhiet insiste : « On constate d’ailleurs une similitude extraordinaire de rhétorique entre tous les groupes qui tentent d’obtenir des mesures préférentielles : la même terminologie et le même argumentaire reviennent exactement chez les handicapés, les obèses, les homosexuels, les autonomistes régionaux, les "Indigènes de la République" ou les féministes ».
Et c’est l’apothéose. Après de laborieuses ratiocinations, l’auteur conclut son article par ceci : « En tout état de cause le pire effet de la discrimination positive se trouve dans l’injustice de son principe même qui a été récemment résumé par le président du groupe l’Oréal : "Lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d’origine étrangère, il a plus de chance d’être recruté que celui qui porte un prénom français de souche". Ce n’est donc pas de l’égalité des chances ». CQFD !
On notera également cette petite perle en début d’article : « Il est absolument contraire à la philosophie occidentale de devoir un recrutement, une promotion ou une prestation de toute nature à son appartenance à un groupe quelconque ». Ah bon, et depuis quand ? L’homme blanc, héritier historique et bénéficiaire, sur tous les continents et durant des siècles, de pratiques sexistes, discriminatoires et racistes institutionnalisées appréciera.
Mais terminons-en. Nous ne prétendons pas ici débattre avec Anne-Marie Le Pourhiet de ses très simplistes analyses. Les lecteurs se feront leur propre opinion. Nous laisserons néanmoins le dernier mot à la romancière et dramaturge guadeloupéenne Gerty Dambury, qui a attiré l’attention de La1ere.fr sur l’article en question : « Fo nou rété véyatif ! » (ce qui signifie en créole « Il faut demeurer vigilant ! »).
Sous l'article consacré, dans cet ouvrage, à l'Affirmative action (expression américaine mal traduite en France par « discrimination positive »), le texte évoque une « discrimination positive massive » en faveur des Ultramarins : « La seule discrimination dont puissent aujourd'hui se plaindre les citoyens français d'outre-mer est une discrimination positive massive : majoration de salaires et de retraites, exonérations sociales et fiscales, subventions à perte de vue, primes de toutes sortes, y compris les voyages gratuits ou à prix réduit vers la métropole au nom de la "continuité territoriale" ». « L'accès à l'université des "domiens" ne pose plus aucun problème », poursuit également l’auteur de l’article, Anne-Marie Le Pourhiet, professeur agrégé de droit public à l'université de Rennes 1, qui reprend à son compte les clichés habituels.
« Retard culturel »
Et ce n’est pas tout. « Enfin les français "issus de l'immigration" », écrit-elle encore, « qu'elle provienne des anciennes colonies ou d'autres pays, ne peuvent se prévaloir d'aucune autre distinction que celle du temps nécessaire à tous les immigrés pour s'intégrer et remonter la pente de la pauvreté économique et du retard culturel qui les a poussés à quitter leur pays. Ce temps varie évidemment selon la capacité et la volonté d'intégration des populations et leur écart socio-culturel avec la société d'accueil. » Il y aurait donc des cultures « en retard » par rapport à d’autres. Mais à quoi juge-t-on « l’avancement » d’une culture ? L’auteur se garde bien de réfléchir à la question.Elle continue : « alors que la situation n'a rien à voir avec les Etats-Unis ou l'Afrique du Sud, il a fallu fabriquer de toutes pièces un prétexte selon lequel les populations "issues de l'immigration" seraient "au quotidien" victimes de discriminations ». Et pourquoi ne pas dire carrément que les discriminations n’existent pas ?
La seule discrimination dont puissent aujourd'hui se plaindre les citoyens français d'outre-mer est une discrimination positive massive : majoration de salaires et de retraites, exonérations sociales et fiscales, subventions à perte de vue, primes de toutes sortes, y compris les voyages gratuits ou à prix réduit vers la métropole au nom de la "continuité territoriale" » (Anne-Marie Le Pourhiet)
Mais ce n’est pas fini. « Il n’en demeure pas moins que puisqu’il faut se dire victime de l’autre pour pouvoir justifier qu’on lui passe devant, le militantisme féministe a aussi forgé son passé discriminatoire », dit-elle. Inventé peut-être ? Anne-Marie Le Pourhiet insiste : « On constate d’ailleurs une similitude extraordinaire de rhétorique entre tous les groupes qui tentent d’obtenir des mesures préférentielles : la même terminologie et le même argumentaire reviennent exactement chez les handicapés, les obèses, les homosexuels, les autonomistes régionaux, les "Indigènes de la République" ou les féministes ».
Et c’est l’apothéose. Après de laborieuses ratiocinations, l’auteur conclut son article par ceci : « En tout état de cause le pire effet de la discrimination positive se trouve dans l’injustice de son principe même qui a été récemment résumé par le président du groupe l’Oréal : "Lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d’origine étrangère, il a plus de chance d’être recruté que celui qui porte un prénom français de souche". Ce n’est donc pas de l’égalité des chances ». CQFD !
On notera également cette petite perle en début d’article : « Il est absolument contraire à la philosophie occidentale de devoir un recrutement, une promotion ou une prestation de toute nature à son appartenance à un groupe quelconque ». Ah bon, et depuis quand ? L’homme blanc, héritier historique et bénéficiaire, sur tous les continents et durant des siècles, de pratiques sexistes, discriminatoires et racistes institutionnalisées appréciera.
Mais terminons-en. Nous ne prétendons pas ici débattre avec Anne-Marie Le Pourhiet de ses très simplistes analyses. Les lecteurs se feront leur propre opinion. Nous laisserons néanmoins le dernier mot à la romancière et dramaturge guadeloupéenne Gerty Dambury, qui a attiré l’attention de La1ere.fr sur l’article en question : « Fo nou rété véyatif ! » (ce qui signifie en créole « Il faut demeurer vigilant ! »).